
Héloïse Guimin
Bénévole à Genres Pluriels
Co-responsable des permanences Genres Pluriels
de Liège et Verviers
(Belgique)
–
Du « modèle transsexuel »1 à l’activisme trans*féministe
ou l’éloge de la déclivité des genres
Comment, alors qu’on a décidé, un jour, d’entamer ce steeple-chase appelé aussi « parcours de transition », ou protocole, se retrouve-ton à militer au sein d’une association trans* et à se coller soi-même l’étiquette « femme trans*féministe » sur le dos2? Comment d’un questionnement profond et individuel, en arrive-t-on à poinçonner toute une organisation sociétale et en vouloir la refonte complète ? En fait, comment d’une assignée garçon se retrouve-t-on à mener des débats sur l’urgence de la révolution des genres et des paroles trans* ?
Ce sont les questions que je me suis posées quand, à l’invitation de Maud-Yeuse Thomas, j’ai pensé ce texte. Ces « comment » se sont tout de suite accompagnés d’un simple « Pourquoi ». Pourquoi, en somme, alors que mon parcours « officiel » s’annonçait bien, que les 10 mois passés entre les mains de « spécialistes » auguraient de bientôt toucher les Graal, j’ai claqué la porte de cette clinique avec le sentiment de l’urgence à agir ailleurs et autrement qu’en subissant l’obligation à justifier ma différence, mes ressentis et mes vécus ?
Pour bien comprendre le besoin irrépressible qui s’est imposé à moi de m’investir en tant qu’activiste au sein de Genres Pluriels3 , je me dois de décrire une partie de mon parcours entre ce moment délicat du coming-out et la prise de conscience de la manipulation dont j’ai été l’objet.
L’aveu public de ma différence vraie, supposée, ressentie et vécue fut, comme pour tous.tes, le fruit d’une longue maturation, de questionnements, de doutes, d’incompréhensions, de discriminations, de douleurs et aussi d’espoirs. Je me souviens avoir pris le temps de rencontrer toutes les personnes qui, pour moi, comptaient à l’époque. Certaines furent abasourdies, d’autres indifférentes ou compréhensives. Je ne savais pas où ces premiers pas allaient me mener. J’avais bien rencontré Max Nisols, de Genres Pluriels, qui m’avait prévenue de l’attitude des équipes officielles et de la désillusion que j’allais y rencontrer, mais je voulais voir par moi-même. Par orgueil, par défi, par besoin de continuer, d’une autre manière, à être intra-normes ? J’imaginais pouvoir tout maîtriser. Ce qui était un leurre.
En parallèle des tests, examens et entretiens avec les psychiatres, psychologue et infirmières de l’équipe de genre vers laquelle je m’étais tournée, j’ai mis en place, ce que nous appelons une transition sociale et, ce, bien avant d’avoir accès au traitement hormonal que j’appelais de tous mes vœux. Cette transition, cet apprentissage de l’expression, et du vivre, de mon identité, s’est faite de manière sereine. La préhension des changements en cours, et à venir, se fit par expérimentations, par tâtonnements, par réappropriations de mon image et de mon corps (toujours inchangé biologiquement). J’appris à accepter que ce que je ressentais, imaginais ou espérais n’étaient pas nocifs pour moi. Que ce qui me suivait, me poursuivait et, parfois, m’étouffait depuis mon enfance n’était pas un danger pour mon équilibre mental ni, d’ailleurs, un déséquilibre.
Et, pourtant, durant les 10 premiers mois qui suivirent mon coming-out (on me pardonnera l’expression) je me suis cognée au mur de la pratique clinicienne la plus butée et la plus transphobe qui soit. Alors que dans mon quotidien je sentais de manière encore innomée que l’expérience de mon « genre » était, non pas décollé, mais simplement ailleurs, s’exprimant sur une autre plateforme, je me retrouvais en face d’un monde médical dont je percevais la volonté de me guider vers un lieu qui n’était non seulement pas le mien, mais que je refusais d’explorer. Durant les tests et entretiens psychiatriques je me suis rendue compte que je sur-jouais certaines de mes appréhensions et de mes dégoûts. J’avais une totale conscience qu’entre ce que je ressentais profondément et ce que je transmettais en entretien, il y avait une fracture dont la nature ne m’échappait pas. Parfois honnête, parfois joueuse, j’ai, par la suite, au fil de mes lectures, dont un article décrivant le syndrome de « Blanche-Neige »4, compris ce qui c’était joué dans ces bureaux : mon avenir identitaire vu et exprimé à travers le prisme de la normalité. Cette normalité a un nom : la binarité naturaliste des sexes et des genres.
Je me souviens fort bien du moment où le psychologue de la cellule m’a annoncé, fier comme un paon, que j’avais réussi les tests et que ceux-ci avalisaient mon discours. Oui, je souffrais de « dysphorie de genre » (je ne connaissais pas encore le terme à l’époque). Ce qui me frappe encore aujourd’hui c’est le besoin qu’avait ce praticien que je me réjouisse de la nouvelle. Il m’accueillait dans la « chouette » communauté des dysphoriques. Je me devais de lui en être reconnaissante. Cela ne m’a en rien irritée, j’ai simplement trouvé cela surréaliste. Tout çà (les entretiens et les tests) pour çà ! La suite n’a été qu’un long bras de fer entre un psy qui exigeait que je lui raconte mon histoire, que je lui dise qui j’étais et, surtout, qui j’étais enfant et, moi, qui subodorait dans cette attitude non pas une volonté d’aide mais un besoin d’avaliser mon identité en la collant sur ses propres références théoriques. La force de ces gens-là est de vous amener, par érosion, à leur livrer ce qu’ils veulent entendre. L’écoute n’est pas égalitaire. Que ce soit dans leur cabinet ou ailleurs vous restez dépendant.e.s et subalternes, des patient.e.s à vie5. C’est l’imposition des mains du praticien sur l’objet qui lui confère la légitimité de sujet. En rien nous, les trans*, ne sommes légitimes avant cette imposition.
Alors, sortant d’un énième entretien, je me suis rendue compte à quel point j’étais manipulée non pas dans un souci de me réaliser mais dans un souci d’avaliser une idéologie qui m’était totalement étrangère. La colère a vite fait place à la conclusion qui est à l’origine de mon activisme ; si j’avais le caractère et le recul pour comprendre cela, d’autres n’ont pas cette possibilité et, victimes de ce jeu pervers, risquent bien de sombrer là où j’ai moi-même failli tomber. Ce jour-là, j’ai décidé que je retournerais à Genres Pluriels pour consacrer mon temps et mon énergie à écouter, soutenir et militer pour une autre route, plus juste et plus respectueuse du vécu de chacun.e. Ironiquement c’est à cette « cellule de genre » que je dois ma motivation de refondre la société qui nous ostracise de manière systématique. Entendu que cette manière est systématique dans sa volonté de nous déclassifier dans un premier temps en erreur de la Nature pour, ensuite, nous soignant (par psychanalyses, thérapies, traitements hormonaux et enfin chirurgies) nous donner la forme voulue et désirée… Mais désirée par qui au final ?
Alors. Qu’est-ce qu’être, pour moi, une femme trans*féministe militante et comment le construis-je, le vis-je et je l’actionne sur différents plans ?
La première chose à comprendre c’est que cela ne s’improvise pas. On ne naît pas plus homme/femme qu’on ne naît trans*féministe. Je dirai même qu’il faut impérativement se dé-construire pour le devenir. Être activiste trans*féministe, à notre époque, c’est hériter d’un passé à la fois court (celui des associations et des études trans*) et plus long, mais pas tellement (celui des luttes féministes et LGBT+). C’est aussi plusieurs dé-s-apprentissages et une re-construction permanente.
« Le flot incessant de nouvelles paroles, le « point zéro », semble être un éternel point de départ ou de recommencement pour chaque génération, qui ignore sciemment ou non, le travail accomplit quelques années auparavant seulement »6.
Quand j’ai pris la décision de m’investir dans Genres Pluriels, j’ai aussi décidé d’observer et d’apprendre car je comprenais inconsciemment que ce que j’avais découvert dans la structure « officielle » attendait des réponses réfléchies. Des réponses qui avaient déjà été formulées ailleurs, autrement et en d’autres occasions. L’observation me permit aussi de réaliser mon propre besoin de penser et d’organiser ce que j’intégrais. Enfin, la rencontre de Karine Espineira ne fit que me conforter dans la certitude que nous devions nous approprier le domaine du discours et des expertises (il n’y a rien à se réapproprier puisque nous n’avons jamais été convié-e-s à la parole excepté pour justifier les théories échafaudées à notre encontre).
Mon parcours d’artiste m’a tôt appris que je faisais partie d’une histoire et que de point zéro il n’était jamais vraiment question. Si, en tant que poétesse je suis autant redevable à Baudelaire qu’aux surréalistes, j’ai compris que ma transition « socio-médicale », pour personnelle qu’elle fut, s’inscrivait aussi dans une historicité qui va de l’accusation de perversité aux diagnostics psychiatriques pour enfin atteindre le champ contradicteur et libératoire des études trans*. C’est donc tout naturellement qu’en parallèle de mon investissement activiste je me suis autant penchée sur les textes des Patricia Mercader, Frédéric Burdot ou Colette Chiland que sur la déconstruction des discours et actions de ces soi-disant experts par des auteur.e.s tel.le.s que Tom Reucher, Françoise Sironi, Julia Serano, Karine Espineira et d’autres encore, dont certain.e.s sont à venir ; une lecture en amenant une autre.
« La force des studies américaines, c’est de ne pas s’être coupées du terrain militant et de la part du terrain militant de ne pas s’être coupé de la théorie »7.
Le terrain. Parlons-en !
Le terrain est le premier lieu du savoir trans* (et de beaucoup d’autres). Quand nous poussons la porte d’une association pour la première fois, en proie à toute une série de sentiments ; crainte, honte, espoir, nous arrivons avec autant de questions que de fausses certitudes, glanées ici et là. Nous sommes à la fois vierges et pourtant déjà formaté.e.s. C’est le constat de mon propre parcours et des accueils dont j’ai la charge à Bruxelles, Liège et Verviers. Au premier regard, toutes les histoires semblent se ressembler et toutes les demandes se recoupent. C’est un fait que j’ai vérifié ; souffrance intégrée et croyance en la puissance miraculeuse du duo hormones/chirurgies sont les discours tenus en général lors de la toute première rencontre ou de la première confession (certain.e.s mettent un temps avant de se « libérer »). Il est rare de voir débarquer une personne qui parlera de son point de confort au premier abord et qui saura expliquer de manière rationnelle sa demande. Le plus souvent, nous devons être à l’écoute d’histoires qui ont une impression de déjà-vu. Il faut être patient.e.s et empathiques. Le « modèle transsexuel » assimilé est puissant, la soumission aux « prérequis » médicaux constante et la confusion entre les termes généralisée. Le seul moyen de guider et de détricoter ces aveux chargés d’une transphobie tournée d’une manière inconsciente vers soi, est dans le partage des savoirs et expériences avec d’autres membres plus expérimenté.e.s ou plus au fait de certaines matières. Il ne s’agit pas de substituer l’imposition activiste à l’imposition médicale mais de susciter le questionnement de la.du requérant en lui opposant au « modèle transsexuel » les modèles transidentaires. En fait, d’opposer aux experts du discours une expertise par expérience. Le résultat est toujours le même ; une prise de conscience de la part de la personne trans* que les possibles sont multiples et que la voie hormono-chirurgicale psychiatrisante n’est pas une fatalité, rejoignant en cela les constatations de Maud-Yeuse Thomas8 que la médecine a créé plus de « transexes »9 qu’il y en avait réellement.
Au-delà du soutien communautaire, le terrain se vit dans des actions politiques et/ou éducatives, les secondes étant toujours empruntes des premières. Genres Pluriels a créé plusieurs groupes de travail pour porter nos revendications tout en analysant l’état de la société dans son abord, ou pas, des transidentités. Les groupes de travail sont : Législation, Médias, Jeunesse et éducation, Santé. D’autres sont à venir comme le GT Formation et, peut-être, un GT Trans*féminisme.s. Ces groupes ont en charge des objectifs bien définis. Ils n’en sont pas pour autant imperméables les uns aux autres et l’ensemble de membres active.if.s doit, au minimum, avoir une vue d’ensemble des thématiques, activités et/ou revendications trans* (je ne parle pas de la situation des personnes intersexuées qui fait l’objet d’une démarche parallèle, même si intégrée, et qui bénéficie d’un GT particulier). Il n’est pas rare qu’un même projet nécessite l’intervention de plusieurs GT à la fois et donc rencontre plusieurs champs d’expertises. L’intersectionnalité est la règle. Cela se vérifie (entre autres) quand nous devons seconder des étudiant.e.s dans leur mémoire ou TFE, les thèmes abordés couvrant un large éventail de sujets : la prise en charge médicale, la quête du point de confort, les situations administratives et législatives, les conditions et/ou discriminations sur les lieux de travail, la sexualité et les risques d’infections, le.s trans*féminisme.s etc… Il nous faut être capables de répondre à toutes les questions posées. L’activisme contemporain (est-il si différent que précédemment ?) nécessite non seulement du temps mais aussi un esprit critique et une capacité à intégrer mille signaux et connaissances en mouvement constant. Car, comment parler de notre proposition de loi si on n’a pas lu les 40 pages de celle-ci sans connaître l’état de l’actuelle loi de 2007 ?10 Comment parler de l’accueil en milieu médical si on ne l’a pas expérimenté soi-même et/ou en écoutant les retours édifiants d’autres personnes, et ce pour en analyser les idéologies sous-tendant cet accueil souvent problématique ? Comment dénoncer le traitement médiatique dont nous sommes les objets si on n’a pas décortiqué les dits médias et compris que ces images portent en elles-mêmes la récurrence d’injonctions discriminantes transphobes ?
Comme pour l’accueil et le soutien, l’entraide est donc la solution à la différence près que la formation révèle un rôle plus important encore. Une formation qui ne peut, alors, qu’être trans-nationale ; les revendications et critiques théoriques parues ailleurs ou acquises dans un autre pays étayant nos discours et revendications nationales. C’est dans cette optique que TGEU, l’ODT. ou les passerelles vers des associations amies (comme OUTrans ou Chrysalide) et les alliances avec les différentes coupoles LGBT+ belges11 sont nécessaires.
Mais qu’en est-il du trans*féminisme dans tout cela ?
Peut-on, à la manière de la philosophie parler du concept de trans*féminisme, le penser et l’élaborer ou devons-nous, comme certain.e.s le veulent parler directement et exclusivement au pluriel et dire les trans*féminismes ? Doit-on, déjà, imaginer un au-delà des discriminations pour ne pas ghettoïser les idées et les revendications, ne se résumant plus, alors, qu’à une longue litanie de reproches qui aurait plus à voir avec l ‘égrainage d’un chapelet en appelant à une force extérieure salvatrice qu’à une véritable refonte de la société contemporaine ? Mais, ce faisant, ne ferions-nous pas le sacrifice de la conception d’un socle commun sur lequel envisager les trans*féminismes et les constructions post-stigmatisation ? J’ai, par ailleurs, le sentiment que ce socle commun est à la fois déjà fondé et théorisé et, cependant, perçu d’une manière trop vague et nébuleuse, voir ignoré. Comme si l’énoncé du trans*féminisme se suffisait à lui-même comme explication pour décrire son propre engagement; chacun.e ayant sa définition qui de par la jeunesse du mouvement, le peu de structures et cet éternel retour à un état prénatal me semble tout de même manquer d’assises.
L’état de mes connaissances ne me permet pas de répondre à toutes ces questions de manière probante (si tant est que cela soit le cas un jour, ce dont je préfère douter), mais je ne vois pas comment faire fi des discriminations sociétales, des injonctions genrées et du «modèle transsexuel » pour penser le concept trans*féministe. D’autres avant moi y ont réfléchi, je ne peux donc que mettre mes pas dans les leurs. Cependant, il me semble que la conception d’un socle ouvert ne peut pas se faire sans envisager la transidentité de manière globale en analysant ce qu’elle engendre comme révolution idéologique et humaine mais aussi en étudiant la manière dont elle est perçue, véhiculée, explicitée et parfois justifiée. Je pense qu’en fait l’idée de base du trans*féminisme est moins le combat contre les discriminations, ou la revendication de nos droits que le remise en question du « plancher naturel sexe-corps »12. Ce plancher agit comme un aimant ou, pire, comme les cases d’un jeu de dames que nous ne pourrions traverser qu’en utilisant un seul axe de déplacement. Malgré la lente évolution des lois et la médiatisation des identités trans*, il y a une impossibilité essentielle à imaginer, envisager et/ou construire (et à fortiori accepter) une autre perspective au bordage naturaliste sexe-genre, inné-acquis, naissance-devenir. On bute régulièrement sur cette réalité idéologique et ce au sein même de la communauté. Sans la remise en question de ce bordage insane, nous serons condamné.e.s à rejouer sans cesse (dans) la même pièce.
Maud-Yeuse Thomas avance que nous reprenons « la révolution beauvoirienne » à notre compte « et la prolongeons en interrogeant ce naturaliste dissimulé derrière l’essentialisme contemporain »12. J’estime que cette « révolution » reste inachevée par le fait, entre autre, qu’une bonne partie de la communauté trans* ne désire pas de celle-ci, au-delà de la revendication hédoniste de nos identités uniques, individuelles et égotistes. Il ne s’agit, souvent, pas d’autre chose que de la réalisation de soi et, ensuite, de notre dissolution dans la société, de poussière à poussière, avec l’illusion que la biotechnique fait de nous des êtres « naturels» et neufs.
D’autre part, ces parcours, qui doivent tant au « modèle transsexuel », ne posent pas la question centrale de la dé-pathologisation au-delà, dans le meilleur des cas, de la revendication à la dé-psychiatrisation. Je postule que la seconde ne réglera pas la première si nous n’en finissons pas avec la croyance qu’être trans* est une affection médico-bio-mentale et non un développement non typique de l’identité genrée. Je ne peux qu’applaudir lorsque Françoise Sironi exhorte ses collègues : « La psychologie géopolitique clinique permet précisément de penser que l’autre est possiblement lié à d’autres forces que celle du thérapeute, d’autres théories de l’existence que les siennes, d’autres ressources, d’autres rêves, d’autres loyautés, d’autres devoirs »13. Dé-pathologiser, c’est oser une autre vision de développement individuel qui ne serait plus à chaque fois ramenée à l’idée que l’on se fait de la Nature. Celle-ci a depuis trop longtemps été prise en otage afin de pousser à l’extérieur de la société civile des pans entiers de la population, servant d’alibi pour classifier les gens, leur refusant les droits et le respect qui leur est/était dû. Sans compter que depuis le XIX° siècle, et le glissement de la morale vers les sciences et la médecine, on assiste à une justification encore plus insupportable des discriminations basées sur les normes et par là sur l’anormalité et le pathologique. Comment ne pas voir dans le traitement médical et sociétal du saphisme au tournant du siècle dernier14 des points communs avec la dé-classification hypocrite des transidentités en « dysphorie de genre » après avoir été cataloguée dans les « troubles de l’identité sexuelle ». Lors de la refonte du DSM IV, Colette Chiland se gaussait bien de nos revendications et « atermoiements »15. On peut imaginer facilement que la dépsychiatrisation ne changera pas le point d’observation d’un monde médical certain de son bon droit et de son indépendance d’esprit face à des personnes malades, souffrantes et à qui il dénie toute capacité à s’élever et à se détacher de leur état troublé. Je reprends à mon compte, en la paraphrasant, cette citation de Geneviève Fraisse et Michelle Perrot : « (notre) destin se joue sur une partition réglée où médecine, sociologie, psychanalyse et esthétique s’accordent pour (nous) dire l’essence de (notre) être féminin (masculin et/ou autres) »16. La dépathologisation n’est pas uniquement une question d’idéologie ou de respect mais de droit à l’Humanité.
Je cite à nouveau Geneviève Fraisse et Michelle Perrot pour parler plus spécifiquement des femmes trans* : « La femme n’existe pas sans son image : ainsi les femmes sont symboles… Et c’est à partir de ces images qu’elles se changent aussi elles-mêmes, car elle savent que c’est un piège »17. Je fais de plus en plus la constatation que les femmes trans* ont rarement un background féministe et ont souvent du mal à intégrer le piège dans lequel leur image peut les enfermer. Auto-identifiées à un idéal de « La Femme », il leur est difficile, voire impossible, d’évaluer cette image sans interroger et/ou condamner cette identification et s’invalider elles-mêmes. Il faut observer avec quelle obsession certaines s’inquiètent de leur « passing » croyant, à tort, qu’il leur revient à elles d’accomplir tous ces efforts alors qu’en définitive, comme l’a si bien démontré Julia Serano dans son « Whipping girl »18, c’est le privilège cis*sexuel19 qui agit comme le révélateur sans appel de ce qui est naturel ou pas et dont les personnes cisgenres ne peuvent se départir dès qu’ils soupçonnent une « non congruence de genre » chez une personne ; modifiant là leur perception et leur attitude alors que rien ne semblait les perturber avant ce « outing ». Sans une réflexion trans*féministe, les femmes trans* sont condamnées à respecter l’injonction sexiste de l’éternel féminin allant, hélas, dans le pire des cas, jusqu’à le singer.
Le constat peut paraître dur ou amer, il n’en demeure pas moins qu’on assiste, plus encore aujourd’hui qu’avant, à un conflit entre celles-ceux qui tiennent au « modèle transsexuel » et celles-ceux qui défendent les modèles transidentitaires. Derrière le chantage aux soins de santé (brandi par le corps médical et intégré par ces personnes), il y a avant tout l’effroi face au changement du paradigme naturaliste et sociétal que peu sont prêt.e.s à envisager. Peut-on leur en vouloir ? Non. Doit-on les accuser de collusion avec l’ennemi ? Non. Peut-on leur reprocher de choisir la paix de l’illusoire « normalité » à la revendication de leur différence ? Certainement pas. Mais la décollation20 sexe-genre et la dislocation des normes genrées afférentes est le seul moyen pour, d’une part, appréhender nos identités multiples et mouvantes et, de l’autre, vaincre les discriminations qui en sont la résultante.
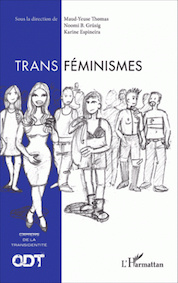
Enfin, « nous tentons alors de déplacer le problème dans le champ de la philosophie, afin de reconnaître les sujets trans* comme des sujets de savoirs et de droits, des personnes pensant, dans leur humanité, les outils de leur émancipation »21. Karine Espineira parle dans ce même article du passage du statut d’insider à celui d’outsider. C’est à dire que certain.e.s d’entre nous auront assez de naïveté ou d’idéalisme, et aussi d’orgueil (avouons-le !), pour risquer le difficile passage du statut d’objet de discours au statut d’observatrice.teur. Ce passage peut être considéré comme un reniement voir comme une collusion. Ces attitudes suspicieuses soulignent, selon moi, à quel point notre statut de victime-patient.e est prégnant ; un statut auquel on ne pourrait, semble-t-il, pas échapper. Ce passage est difficile à appréhender car souvent vous l’empruntez seul.e, sans garde-fou, avec le risque de briser le lien qui vous lie au terrain. L’observation peut être vue comme une volonté de vous imposer, de dire une seule voix, la vôtre, et ce l’est en quelque sorte. C’est pour cela, qu’encore et toujours, vous devez rester en contact avec ce terrain qui pourra vous juger sévèrement mais qui, en retour, vous offrira la première légitimité d’expertise. Ce défi comporte en lui-même les ingrédients de notre propre exclusion du groupe que nous étudions et qui est aussi le nôtre.
Il est donc difficile, pour nous trans*, de passer la barrière qui légitimera nos savoirs. Nous sommes victimes de nos confessions, devant sans cesse nous justifier, nos discours seront toujours chargés d’historicités diverses et d’affects même et (peut-être) surtout quand nous tentons de dépasser, ou de nous élever au-dessus de ces divers vécus pour en détacher une/des analyses. A chaque fois, nous serons ramené.e.s à l’affirmation individuelle de nos existences et identités. Je dirais aussi que vu que ce savoir, non seulement a peu de racines mais qu’il n’est pas un sujet savant (excepté pour nous pathologiser) nous sommes tous.tes obligé.e.s de suivre des parcours de formations autodidactes, avec tout ce que cela peut générer de mépris de la part d’un monde « académique » engoncé dans son dictionnaire. En même temps, nos démarches multiplient les notions et leur préhension, ce qui n’est pas pour rassurer les diverses composantes de la société qui se retrouvent face à une toile qu’elles assimilent au chaos et à l’auto-légitimisation narcissique. Pour autant, je vois dans cette multitude d’expressions la preuve de la vitalité de nos expertises et la volonté irrépressible d’imposer quoi qu’il ne nous en coûte une voix/voie qui au-delà des pluriel.le.s est/sont commune.s.
Au final, pour moi, le trans*féminisme naît d’une assignation (souvent toxique) refusée et combattue dans une construction genrée héritée du patriarcat et que nous devons impérativement dé-construire pour atteindre une trans*identité qui ne devient féministe que part dislocation des genres assignés et élevés en modèles naturels. On ne peut être trans*féministe si on ne dé-construit pas l’idéologie politique sur laquelle nous avons collé, un temps, notre propre perception de nous-même.

Notes :
- 1. Le modèle transsexuel » : Partant de ce que Karine Espineira appelle le bouclier thérapeutique, j’y associe aussi la volonté de certaines personnes trans* à accepter de manière active autant ce bouclier que l’idéologie naturaliste des sexes et des genres justifiant l’organisation politique, morale et sociale de notre société. Organisation basée sur une vision falsifiée de la Nature qui sanctionne l’instauration historique de normes excluantes et discriminantes.
- Chaque identité étant mouvement de manière à la fois interne et extérieure. Étant donné, également, que l’identité globale est un conglomérat d’identités parcellaires ou complètes, en construction, elles-mêmes à la fois figées sur un moment donné et/ou en mouvement, cela donne un tableau assez proche d’un nuage à la fois immobile, se déplaçant sur lui-même et dans tous les axes qui lui sont offerts. La dé-construction est non-définissable et impossible à circonscrire. Pour paraphraser Jacques Derrida, elle est ce qui advient au présent et, si je la pense en matière de transidentités elle est un questionnement répété dont la réponse n’est ni homme, ni femme mais le questionnement lui-même.
- Qu’il me soit permis ici de remercier spécialement Max, Londé, Maël, Jih-An et surtout, Aurore et Ely pour les heures de conversations, de partages et d’actions. https://www.genrespluriels.be/
- Aude Michel et Christian Mormont in « Blanche Neige était-elle transsexuelle ? » ulg. Dans cet article les auteur.e.s tentent de démontrer l’existence d’une phobie-contre-phobie de la castration chez les sujets F-trans*. Je n’ai guère la place de développer mes idées ici, je renvois donc le lecteur au chapitre « Maltraitance théorique et hypocrisie professionnelle » du « Psychologie(s) des transsexuels et des transgenres » de Françoise Sironi.
- cfr l’interview de Tom Reucher « Qui sont les experts ? in Cahiers de l’ODT : Transidentités ; histoire d’une dépathologisation » pg 92. L’Harmattan, 2013
- K. Espineira, M.Y. Thomas, N.B. Grüsig in « Cahiers de l’ODT : Trans*féminismes » pg 13. L’Harmattan, 201
- K. Espineira, M.Y. Thomas, N.B. Grüsig in « Cahiers de l’ODT : Trans*féminismes » pg 14. L’Harmattan, 2016.
- Maud-Yeuse Thomas « Pour un cadre générique des transidentités in Cahiers de l’ODT : Transidentités ; histoire d’une dépathologisation » pg 25-34. L’Harmattan, 2013
- J’emprunte le terme à Maud-Yeuse Thomas qui définit ainsi les personnes ayant bénéficié d‘une « opération de conversion sexuée » (autre expression de la sociologue).
- A l’heure où j’écris on sait que le gouvernement belge va proposer une nouvelle loi concernant les transidentités. Auparavant, et pendant deux ans, le GT Législation de Genres Pluriels a travaillé en partenariat avec l’Equality Law Clinic de l’ULB, le Ligue des droits de l’ Homme, Amnesty Internationnal, et les trois coupoles LGBT+ du pays -çavaria (Flandres) La Rainbow House de Bruxelles (Région Bruxelloise) et Arc-en-Ciel Wallonie (Wallonie)- à la rédaction d’une proposition de loi émanant du monde associatif. https://www.genrespluriels.be/Loi-Trans-un-avant-projet-de-loi-845!.
- Il faut savoir que tant à Bruxelles qu’à Liège et Verviers nos permanences se déroulent au sein des bâtiments des différentes Maisons Arc-en-Ciel. Je ne peux ici que saluer les collaborations respectueuses avec les différent.e.s membres des trois maisons.
- Maud-Yeuse Thomas, La société binaire en question, Colloque des UEEH, 2007, (en ligne) http://natamauve.free.fr/Stima-queer/colloqueUeeh.html.
- Françoise Sironi « Psychologie(s) des transsexuels et des transgenres », pg 66-67. Edts Odile Jacob, 2011.
- Nicole G. Albert « Saphisme et décadence dans le Paris fin de siècle », Edts De la Martinière, 2005.
- Colette Chiland, « Les mots et les réalités », L’information Psychiatrique n°87, pg 261-267. 2011.
- Michelle Perrot et Geneviève Fraisse in « Histoire des femmes en Occident t. IV. Le XIX° siècle » pg 16. Tempus, 2002.
- Michelle Perrot et Geneviève Fraisse in « Histoire des femmes en Occident t. IV. Le XIX° siècle » pg 23. Tempus, 2002.
- Julia Serano, « Manifeste d’une femme trans* et autres textes » pg 69-73, Edts tahin party, 2014.
- Julia Serano entend par ce terme ce que nous définissons comme cisgenre. Mais je ne l’ai pas utilisé dans cette acceptation mais afin de souligner le fait que pour la grande majorité des personnes cis* le lien sexe-genre est naturel et logique, ne faisant qu’un, ramenant tout au seul sexe biologique. Aussi, et là je rejoins Serano, le privilège cis*sexuel est la certitude qu’ont les personnes cis* que leur genre est plus naturel que celui des personnes trans* et qu’elles peuvent être jugées à l’aune de cette soi-disant naturalité.
- Dans ce texte, le terme décollation est utilisé selon deux axes différents. Le premier a trait à la scission du lien convenu entre le sexe biologique et le genre considéré par le monde médical comme problématique et pathologique alors que, dans la seconde utilisation, dans le contexte transidentitaire militant, la décollation désigne, pour moi, le développement non typique du/des genres sans idée de jugement moral ou de valeur et comme relevant uniquement du factuel et d’une volonté politique de négation de ce lien. Sans compter que le terme désignant la décapitation, il me semble chargé d’une puissance d’évocation intéressante.
- Karine Espineira, « Pour une épistémologie trans et féministe : un exemple de production de savoirs situés », Revue Comment s’en sortir, (en ligne) https://commentsensortir.files.wordpress.com/2015/12/css-2_2015_espineira_epistemologie-trans-et-feministe.pdf.

Genres Pluriels
Genres Pluriels est une association œuvrant au soutien, à la visibilisation, à la valorisation, à l’amélioration des droits et à la lutte contre les discriminations qui s’exercent à l’encontre des personnes transgenres/aux genres fluides (personnes en transition, drag kings/drag queens, tra(ns)vesti.e.s, butchs, androgynes, queer,…) et intersexuées. L’association se veut non seulement une structure d’accueil et de soutien pour ce public ainsi que son entourage, mais aussi une plateforme d’information, de formation, d’action, de vigilance, de recherche – dans une démarche de travail en réseau avec tous les acteurs d’une société ouverte à la diversité des identités humaines et culturelles. Créée il y a 10 ans, elle fêtera ses 10 ans d’existence en 2017.
Sa structure interne, outre un C.A. et un staff comporte, différents Groupe de Travail (GT) ayant chacun une/des spécificités. Ils se réunissent une fois par mois :
Le GT Santé s’occupant des questions liées à la santé, des rapports avec les mondes médical et social.
Le GT Législation a pour sa part, travaillé à l’édification de notre proposition de loi et au lobbying politique afin de changer la loi de 2007 afférente à la « transsexualité ».
Le GT Jeunesse et éducation s’occupe des étudiant.e.s et des discriminations vécues en milieux scolaires. Ses membres tentent de sensibiliser les différents intervenants du monde estudiantins aux problématiques et thématiques trans*.
Le GT Médias analyse les médias, accueille les stagiaires et demandent de TFE et de mémoires. Ses membres sont souvent amenés à participer à des débats et des interviews en lien avec les transidentités et les personnes inter*.
Le GT Intersexué.e.s s’occupe exclusivement de la thématique des personnes inter* et de la revendications de leur droit, entre autres, à l’autodétermination et bien entendu à la dépathologisation.
Le GT Formation forme de la formation de témoins ciblés afin qu’iels puissent porter les revendications de l’association de manière claire et intersectionnelle. Le GT est aussi en charge de la formation des formateurs.trices dans le but de donner des formations externes sur les transidentités aux différentes secteurs de la société civile (syndicat, hautes écoles, thérapeutes, médecins et aussi toute personnes désirant suivre nos formations).
Le GT Transféminisme.s et études trans* est dans les cartons et se penchera sur la théorisation du mouvement et les moyens de promouvoir celle-ci.
Nous proposons aussi, grâce à nos deux psychologues formés à la thématique et à la militance trans* des accompagnements thérapeutiques individualisés, respectueux de chaque parcours et de chaque demande.
Enfin il existe une série d’ateliers (Drag-King, de Féminisation), de groupes de paroles (pour les personnes trans* et inter*, un autre pour les proches) sans oublier les 4 permanences mensuelles de Bruxelles, Liège, Tournai et Verviers.
Enfin l’association comporte plus de cent membres et une assise bénévole d’une vingtaine de personnes.
adresse : https://www.genrespluriels.be/
Mis en ligne : 06.04.2017







