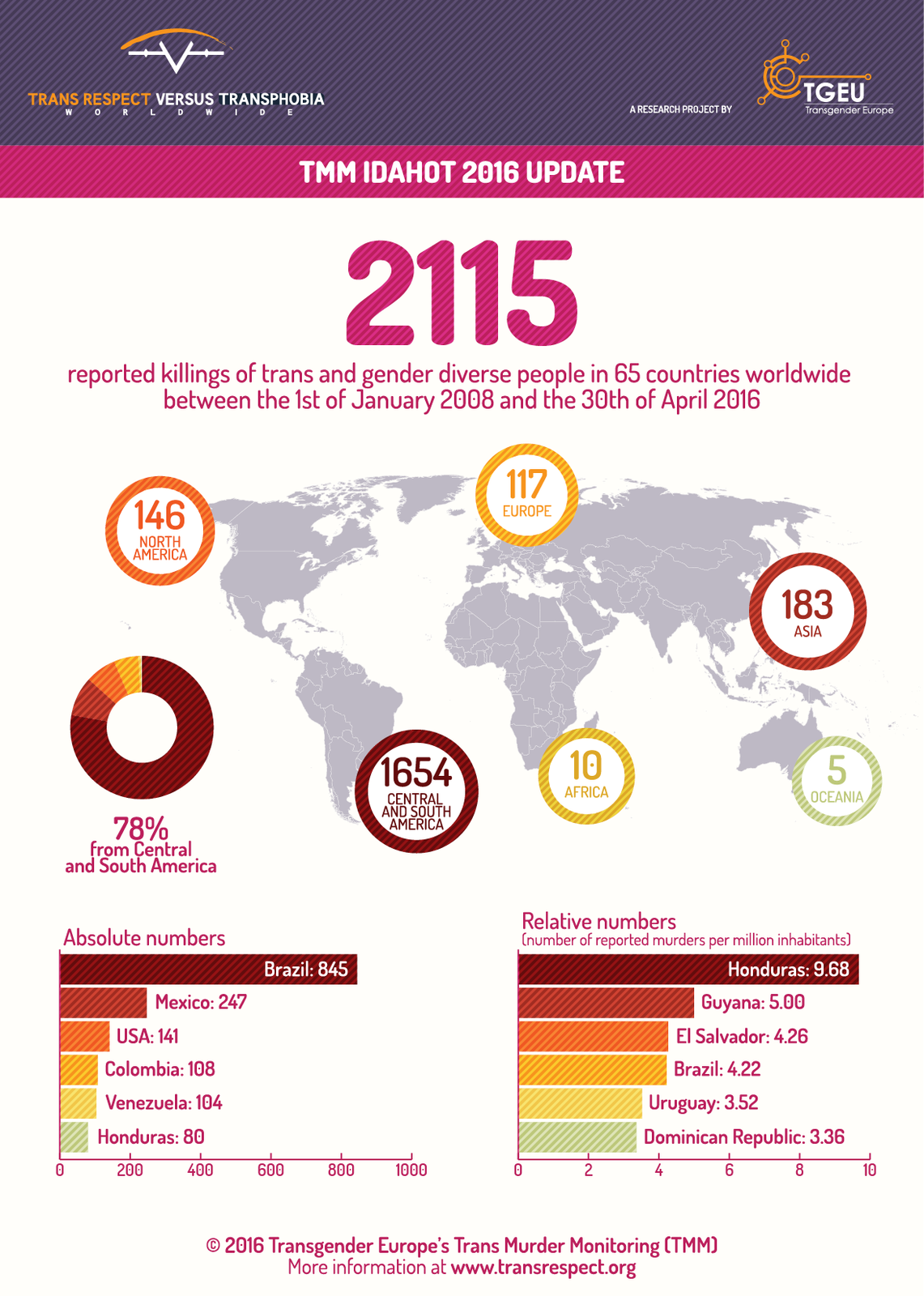Maud-Yeuse Thomas, Karine Espineira, Héloïse Guimin-Fati
Avignon 2018 ou le paradigme trans sur scène
Avignon. Il y a déjà de cela un an, Olivier Py nous promettait un festival 208. Et déjà, le titre ; « Le prochain festival d’Avignon sera « transgenre »[1] » ; et les mots qui fâchent : transsexualité, transsexualisme, déboulent de nouveau dans nos vies :
Après avoir fait honneur cette année « aux femmes puissantes », l’édition 2018 s’intéressera à la « trans-identité et à la transsexualité » a annoncé mardi le directeur du festival. »
Un projet mais surtout un cadre que Py fixe ainsi :
« Olivier Py, qui vient d’être reconduit pour quatre ans, s’est fixé pour objectif de « toujours améliorer la démocratisation ». »
Rapidement, nous sommes contactées par le Centre LGBITQ d’Avignon, La langouste à bretelles pour lequel nous avions fixé.es une formation interne. Puis d’autres assos dont Genres Pluriels de Bruxelles. Pour nous et La Langouste, aucun doute : on doit le contacter et lui parler pour éviter ces mots en leur donnant un contenu et une réhistoricisation. Pendant des mois, on patiente. La Langouste nous assure que le lien va être fait. Les gens du Festival sont très occupés, les agendas sont pleins. On patiente donc. A six mois, rien. A trois mois, rien. Et puis, on comprend qu’on ne va pas en être. Dès la première annonce, on comprend. John Doe (encore un) est l’invité expert extérieur. Depuis des mois, il se présente aux journalistes comme le nouvel « expert des questions des transidentités » tandis que la Sofect, fort de son renforcement aussi général sur les mêmes questions en France, déclare qu’elle se renomme, fort du terme de transidentité dont elle en fait son nouveau label pour un accompagnement et un protocole « allégé ».
Améliorer la démocratisation par un transwashing ? Le Centre LGBTIQ d’Avignon s’est trouvé lui-même écarté. Fini les médiations, l’attente du téléphone, l’envie de bousculer des incompétences criantes. Même les deux cinémas d’Avignon ne veulent plus entendre parler des militant.es. Il leur faut des « experts extérieurs ». Des vrais. Il est vrai que dans un contexte de pinkwasking le transwashing est du petit bois. L’OPA est donc totale.
Pour qui voulait entendre un vrai débat sur les questions trans comme étant des questions de genre, en questionnant la hiérarchie binaire de la société occidentale et son système sexe-genre hétéronormé, là encore c’est loupé. Nous n’avions pas la moindre chance de proposer un changement de ton dans le choix des mots, la manière de les exposer, le choix politique des savoirs situés, la manière de les articuler à d’autres combats plus que jamais nécessaires dans cette ère anthropocène qui est également celle des retours des sécuritaires et identitaires à l’heure d’un Mondial de l’argent et du retour des fascismes. Une fois encore, on est dépossédé de nos vies et mots, luttes et colères, par ceux-là même qui parlent démocratie, sciences, liberté.

TRANS (MES ENLLA). Direction Didier Ruiz
Revue de presse
Avec le temps, la thématique Genre s’est muée en thématique Transgenre. Et inversement. Côté programmation, le sujet focalise sur des témoignages choisis avec le spectacle de Didier Ruiz[2]. Le déroulé suit les habituels progressions :
« Clara, Sandra, Leyre, Raúl, Ian, Dany et Neus arrivent au plateau et se présentent comme ils sont : des hommes et des femmes, longtemps assignés à un genre, dans un corps vécu comme une prison. Et quand ils s’en échappent enfin, le monde refuse de reconnaître leur véritable apparition. La violence, la rue, les institutions, le harcèlement au travail, la stupeur familiale, ils ont connu… De Barcelone, d’où ils viennent et où Didier Ruiz les a rencontrés, ils se mettent à témoigner. »
Il s’agit avant tout de témoigner, faire savoir, faire réfléchir exposer en s’exposant. Or, on ne connaît que ça, exposer en s’exposant. Mais ici, on est dans un cadre protégé qui peut permettre cela : la confiance quand on est sur une scène sécure lorsque l’on a connu que la peur, le risque, l’insulte, la honte, la rupture familiale violente, la déscolarisation, ça vous change un.e trans. Ruiz en nourrit son théâtre, la rue comme elle est, la démocratie est comme elle est.
« Ouvriers, adolescents, chercheurs, ex-détenus, transgenres : pour Didier Ruiz, rencontrer les acteurs de la société en les impliquant dans ses créations engagées et politiques selon le procédé de « la parole accompagnée » est une préoccupation permanente. Ainsi naissent ses spectacles, de la confiance acquise les uns envers les autres, de la parole libérée qui s’écoute et se propage. »
Confiance acquise, parole libérée. Ruiz sait où marquer les esprits. Sur scène. Une scène qui s’arrête à la scène. Il reconnaît lui-même que Barcelone n’est pas la France où la psychiatrie est encore toute puissante avec une Sofect omniprésente ayant fait main basse sur les vies trans. Elle aussi se réclame d’une parole accompagnée. Certes, il y a une différence. Mais demain, après la scène ? La confiance acquise va-t-elle permettre des transitions plus fluides, moins de psychiatrie et plus de justice ? La communication qui s’organise autour commet déjà ses impairs derrière des détours larmoyants qui veulent être rassurants :
« « Trans (més enllà) », proposé par Didier Ruiz au Festival d’Avignon, donne la parole à des personnes transgenres. Elles racontent leur long chemin pour réconcilier leur tête avec leur corps. Un moment de partage, de respect et de douceur. »[3]
Voilà pour le côté scène. Le côté jardin est plus enlevé :
« Ce sont ces oubliés que l’on marginalise, que « Trans (més enllà) » met en lumière. Sandra, Clara et Leyre étaient des hommes, Danny, Raul, Neus et Ian le sont devenus aujourd’hui. »
« Etaient des hommes »… L’incompétence au service du spectacle de la transition dans les bornes de la société binaire et du naturalisme occidental braquant son projecteur sur les sexes en parlant « genre » dans un monde où n’existent que des hommes et des femmes. Sophie Jouve reprend l’item discriminant, pathologisant et psychiatrisant des discours médicalistes, qu’elle nous narre ainsi :
« Raul entre en scène et, surprise, il nous raconte l’histoire du vilain petit canard qui a subi bien des vicissitudes avant de devenir un beau cygne. Ruiz évince d’emblée tout sensationnalisme, ancre son spectacle choral dans une culture commune. Comme le petit canard, les sept personnes qui vont témoigner tour à tour ont connu un long et douloureux chemin avant de se trouver. »
Surprise ? Vilain petit canard, beau cygne. On croit rêver dans cette narration à la mode Disney. L’auteure n’a pas la moindre idée de ce qu’est une transition et comme des milliers d’autres, nous assure de la bonne méthode. Ruiz sait de quoi il parle : il écarte « d’emblée tout sensationnalisme ». L’expression « Etaient des hommes « n’en est pas une. Voilà le genre de sensationnalisme sur quoi reposent les mots, thèmes, stigmatisations et discriminations de transsexualité et transsexualisme que les militant.es trans du monde entier ne veulent plus entendre. Non seulement pour les mots et ce qu’ils portent -spectacularisation, marchandisation, focalisation et falsification psychiatrisante ou sociologisante- mais pour le contexte tout entier dans une démocratie indigne de son nom. Pire ou plus banal : les discriminations forment l’un des terrains de recherche les plus convoités du sociologisme postgoffmanien nourri aux stigmates. Un peu de pédagogie aurait balayé au moins sur le devant de scène. Mais voilà, le contexte de ces mots balayés, ne reste justement que la promesse d’éviter le sensationnalisme dans un sujet qui a toujours fait sensation. Et pour cause. Il est l’exception nécessaire et suffisante pour la société binaire cisgenre et son mode de compétition généralisé. Il est aujourd’hui l’incarnation de ce « vilain petit canard » sur lequel gloses, théories et pratiques se nourrissent, font carrière. Quand les gens luttent depuis leur enfance pour se voir connus et reconnus, on leur jette à la figure qu’elles « étaient des hommes », des hommes devenues femmes… Les hommes, justement, ont de quoi nourrir leur stupéfaction. Quoi, un homme qui veut devenir une femme ? Appelez le psy ! Ou le meurtre. La parole accompagnée de Ruiz les fait témoigner de leur douleur, du silence et c’est bien. Il connaît manifestement son sujet. Ou le contexte de ce sujet avec une citation choc de Jean Genet et un choix des mots précis :
« « Les transsexuels sont des révolutionnaires, des figures de la résistance. » Jean Genet.
« J’ai envie d’interroger l’enfermement, avec ceux qui ne se reconnaissent pas dans le corps avec lequel ils sont nés ou l’identité qui leur a été attribuée. La société, la culture, la famille, l’éducation nous oblige à être en accord avec notre corps, l’intérieur et l’extérieur doivent impérativement correspondre. Et celles et ceux pour qui il n’y a pas de correspondance, qui sont enfermés dans un corps étranger, qui rejettent l’identité de genre assignée ? Comment poussent-ils un cri pour se faire entendre ? Qui est là pour les entendre? Avec quelle réponse? Où est la normalité ? Dans la dignité ou dans la curiosité malsaine ? Où est la monstruosité ? Dans la différence ou dans l’intolérance ? »[4]
Mais cela ne se suffit pas. Sans compter que cela a déjà été dit, médiatisé et déformé des milliers de fois dans une télévision cannibale qui dévore tout et d’abord, ce type de témoignages renforçant la binarité sociétale et sa « normalité » à l’ombre de son naturalisme sexuel, où l’on accepte de se surexposer en se disant que peut-être ce sera la dernière génération à devoir le faire dans de telles conditions pour un tel contexte d’inégalités, de méconnaissances aggravées par un contexte d’egos faisant parler la « révolution transgenre ». L’article comme la scène n’évite pas ainsi l’ancien prénom et le nouveau, histoire de bien marquer la transition entre deux pôles fixes qu’est l’homme et la femme. Enfin, l’homme ou la femme. Bien séparés, bien opposés, bien reconnaissables par leur apparence de genre et tant pis pour les passings imparfaits, les moches et gro.sse.s, ce que l’on détecte d’un coup d’œil. Là où Ruiz explique le contexte à propos des changements de genre en Espagne impliquant que « c’est la révolution de demain », la journaliste en change les coordonnées et met dans la bouche de Ruiz cette phrase : « les « trans » sont la révolution de demain ». Or Ruiz parle de la facilitation du changement juridique, la différence de traitement en Espagne et en France[5], de l’empathie qu’il a vécu face à ces personnes et se sent presqu’obligé de pointer « leur singularité ». En un mot, Ruiz parle le langage des conditions de vie, cachées ou visibles, des « trans » pour dire sa propre place où quand dire, c’est faire :
« Ce n’est pas la communauté des « trans » qui m’intéresse, c’est leur singularité. Tout ce qui participe à la réduction de nous-mêmes dans des cases -homme, femme, homo, bi, trans – est redoutable pour moi. ».
Le Monde n’évite pas plus l’écueil :
« Dans « Trans (més enllà) », Didier Ruiz met en scène sans pathos des individus qui racontent comment ils ont changé d’identité sexuelle. »[6]
L’auteure méconnaît la différence entre identité de genre et identité sexuelle. Ainsi, des « individus » changeraient d’identité sexuelle pour changer de sexualité et (enfin) devenir soi. Curieux mais banal. Les Echos s’en donnent à cœur joie :
« Après avoir fait monter sur les planches des personnes âgées, des ouvriers, des ados, des ex-taulards, Didier Ruiz réunit un groupe de transsexuels barcelonais (…) Pas ou peu d’artifices : les entrées et sorties sont réglées simplement. Les transsexuels s’expriment le plus souvent immobiles, face au public. »[7]
Le clou est enfoncé lorsque l’auteur, très en veine, sort sa répartie : « Trans » n’est pas du happening militant, c’est un théâtre d’âme. ». On est ici dans la vraie vie, celle qui saigne, qui fait mal, des « paroles d’innocents », clame J. F. Cadet[8], là où l’âme palpite et fait réfléchir sur l’époque et les injustices. Les militants dehors.
Nous ne voulions justement plus que cela arrive comme ce type de déroulé. Nous avons milité puis nous nous sommes engagés dans une recherche dans le cadre des études de genre en socio et anthropologie et en études des médias pour y répondre sans jamais perdre de vue les terrains, leurs contextes locaux, nationaux et internationaux. Sentir quelques vents furieux venir, le Festival propose un glossaire afin de résoudre en amont quelques épineuses mésinterprétations. Les universitaires invités se proposent et s’y collent dans l’inimitable style académique assorti des autocitations datées avant de retirer in extremis leurs noms. Une histoire de vents furieux, sûrement. La psychiatre française la plus connue et ayant le plus milité et publié, Colette Chiland, vouait déjà aux gémonies ces « militants en colère », coupables à ses yeux de rire de sa discipline et de faire une « propagande nazie ». Même les fureurs de la théorie-du-genre n’y avaient pas pensé. C’est dire.
Même volonté de bien faire chez David Bobée et son titre prophétique : « Mesdames, messieurs et le reste du monde ». Aux unes et aux uns, une marque de civilité, aux autres, le reste ou les restes. Un titre qui n’est pas sans faire penser à l’ouvrage de Kate Bornstein, militante transféministe, Gender Outlaw: On Men, Women and the Rest of Us ? Pour Bornstein, « Nous » c’est ce peuple manquant, sans papiers, non nommés et confinés à incarner ces Gender Outlaw.
« Qu’est-ce que le féminin? le masculin? Le choix d’Avignon de se saisir de ce thème a déjà fait grincer les dents des autorités religieuses dans la Cité des papes, l’archevêque de la ville Mgr Jean-Pierre Cattenoz, ayant réclamé que le festival ne soit « plus centré sur l’homosexualité et le transgenre ». »
Une question utile mais à condition d’y répondre. Un rappel utile mais vain car on ne sait du rôle du religieux que la discrimination. On oppose donc à l’autre : parole accompagnée par les savoirs, discrimination accompagnée par les croyances. Sans compter que cette focale dissimule les véritables murs de la société inégalitaire occidentale et son régime ontologique déduisant des « identités » et « essences » d’hommes et de femmes… et nul.le autre, ce « reste du monde » ou ce qu’il reste du monde. Rien ici du rôle de la psychiatrie prétendant diagnostiquer des maladies, troubles et autres dysphories et incongruences « de genre ». Rien des réformes juridiques de l’état civil, ces identités de papiers plus décisifs que des vies, gens et genres réels. Montrer les misères du monde n’a jamais résolu les problèmes de fond.
Du « genre », thématique de l’année, a donc largement puisé dans les thématiques trans et ce n’est pas un hasard. Ce n’est plus cet épiphénomène marginal campé et objectivé par la psychanalyse lacanienne et cette forme politique de psychiatrie de ville, mais le prétexte d’une pointe avancée d’une révolution plus générale, plus « systémique » en écho à la question, qu’est-ce que le genre, le corps, l’identité, le féminin, le masculin, dont les « trans » en sont les hérauts désignés et appelés, heureux ou malheureux, brutalisés dans la rue et choyés sur scène, interrogés désormais par la sociologie et, de nouveau, l’anthropologie qui avait délaissé ce sujet :
« Et justement, de quoi parle-t-on, quand on parle de « genre » ? Le premier travail mené par David Bobée et son équipe est d’abord pédagogique, tant la notion est encore imprécise auprès d’une bonne partie du public. « Le genre, disait l’anthropologue Françoise Héritier, est un arsenal catégoriel qui classe (…) en ce que les valeurs portées par le pôle masculin sont considérées comme supérieures à celles portées par l’autre pôle. » »[9]
Le rappel des travaux d’Héritier est utile pour rappeler son ouvrage princeps, la valence différentielle des sexes[10], thème sous-jacent à la thématique Genr,e pour laquelle on fait appel à des expertises, moyeu de la gouvernance biopolitique. Mais, hors de la scène et cette manière de surfocaliser un thème, quelle recherche et réflexion véritables sur la société inégalitaire qui n’en finit pas de ne pas en finir avec l’inégalité homme/femmes et nous propose une thématique genre sans les « singularités de genre » et écartant ce qui constitue le lien social avec ces « vrais gens ». Py a une réponse tout trouvée : « la liberté fait peur »[11].
Ainsi, lorsque l’on examine les images d’événements relatifs au travail « sur le genre », on est frappé par la manière dont le travail sur le travestissement est différemment posé et interprété selon que les individus sont hétérosexuels ou homosexuels, binaire ou non, cisgenre ou non, trans ou non, intersexué.e ou dyadique. Le différentiel entre adultes hommes et femmes est particulièrement frappant : les hommes surinvestissent les marqueurs féminins, les femmes dégenrent leur apparence afin d’échapper à « la-femme », cet engeance masculine-patriarcale, aux harcèlements, à la culture du viol. Ce qui n’empêche pas Py d’affirmer que : la différenciation homme-femme est obsolète. […] C’est parce que [l’humanité] est Une qu’elle est multiple, c’est quand elle est double qu’elle ne l’est pas”. Les phrases-chocs n’ont jamais rien d’apporté de bon.

Saison sèche
Saison sèche, Phia Ménard
« Dans une scénographie visuellement renversante, Saison sèche orchestre un rituel pour détruire la maison patriarcale. Bien décidée à en finir avec l’oppression masculine, Phia Ménard fait montre d’une puissance vengeresse, qui n’échappe pas aux stéréotypes. »[12]
Sans détour, Phia Ménard situe l’assignation du côté du patriarcat. Un « patriarcat qui dure déjà 2000 ans », en ordre de marche, selon un pas cadencé « idiot », « répétitif », toujours le même, signant là l’obéissance à un ordre, une soumission disciplinaire totalement intériorisée et ignorée au point de déterminer un corps cadencé comme étant naturel. Phia Ménard dit là la société disciplinaire selon Foucault. Ce « geste masculin par excellence », titre France Culture[13]. Discipliner le corps, c’est le genrer de telle façon à ce qu’il soit univoque, sans aucune interrogation.
« La colère intime de Phia Ménard la pousse à singer des stéréotypes, à caricaturer des comportements primitifs qui prennent le masculin par le petit bout de la lorgnette et ne lui laissent aucune chance d’éclore dans toute sa diversité. Moins fin et mystérieux que ses précédentes productions, il n’en conserve pas moins une puissance ravageuse. La maison patriarcale à terre, reste désormais à reconstruire une société aux fondations plus égalitaires. »
Le journaliste tente bien d’en atténuer la puissance en pointant la « colère intime », cette vieille engeance psychologisante si présente dans les textes psy depuis plus de 50ans. Parce que Ménard dénonce des stéréotypes, des stéréotypes lui sont opposés. Le pas cadencé est relu comme un « comportement primitif » quand il est un ordonnancement et un ordre. Une société en marche, dit l’autre où la « maison patriarcale » n’est nullement à terre.
« Phia Ménard est porteuse d’une expérience singulière du patriarcat. N’étant pas née dans le corps de femme qui est aujourd’hui le sien, elle fait chaque jour l’expérience de renoncer au privilège d’un corps masculinisé, appartenant au camp des prédateurs, même inconscients de leur pouvoir. Elle apprend à vivre dans un corps féminisé, corps scruté, immédiatement sexualisé, auquel sont constamment indiquées les limites de sa liberté. »[14]
Cette brève resitue son parcours, tant professionnel que personnel, dit d’où exsude cette colère comme s’il fallait la traquer ou l’excuser. Elle n’est nullement « intime » mais politique, sociale, culturelle, et devrait concerner tout le monde. Devenir-femme devient ici synonyme de renonciation au privilège masculin en en faisant découler l’expérience trans MtF. C’est un ordre politique et théologique qui inscrit là dans la matière (des corps, des identités, des architectures) la différence, binaire, cisgenre et politique « des sexes ».
Quel bilan ?
Py philosophe après Py, metteur en scène. Voilà en résumé ce qui ne va pas. Outre que la distinction et différence homme/femme n’est nullement obsolète, elle reconduit la surfocalisation sur ces « trans » qui n’en peuvent plus d’être ainsi désignés pour être instrumentalisés et finalement plaqués comme cibles nullement collatérales des violences de la société patriarcale. On fait parler une agora où les concerné.e.s sont rarement ou jamais appelé.e.s comme experte.s de leurs questions, mais comme spectateurs.trices ou témoignant.e.s d’une histoire qui leur échappe mais dont on meurt toujours. Cela même que Ménard dénonce.
Le festival a reconduit la gouvernance patriarcale qui sait, fort de l’expert patenté, en reconduisant là la société de contrôle. Les bonnes intentions n’ont guère été plus loin que l’ignorance et la reproduction sociale sur lesquelles l’ordre binaire et cisgenre siège, persuadées de faire le bien ou d’apporter de la bienveillance ou des mots rassurants pour « changer les mentalités ». Hurler à la « révolution » attise les retours de haine et attire les prédateurs et profiteurs de toutes sortes. Le Centre LGBTIQ d’Avignon, finalement invité in extrémis à dire quelques mots et revendications, s’est perdu dans la foule, simples cris sans relief dans une massification bienheureuse invitée à « démocratiser le genre ».
Les dizaines d’articles depuis un an sur ce festival disent explicitement une suite ininterrompue de mésusages et mésinterprétations, cliquant sur les sentiments et émotions et non les faits et des véritables recherches de terrain qui ne peuvent en aucun cas reposer sur un seul chercheur, a fortiori non concerné par la problématique. Mais, c’est justement cela qui a constitué la projection valant pour fond en prétendant organiser un débat de société. Ce n’est pas ainsi que les choses se font. On n’applique pas à un sujet dont on ignore jusqu’aux usages de son vocabulaire et son pendant, le sillage classant et stigmatisant, cœur des reproductions sociales. Py a-t-il fait le pari d’une gagne sans le respect des terrains qui peinent à exister face à une Sofect hégémonique et un pays qui refuse de rendre à ses citoyens leur état civil ? Ce pari narcissique est indigne et ce n’est pas quelques beaux textes et sorties qui font la différence. Demain, la transphobie continue son travail de stigmatisation, de pauvreté et d’isolement. Et cela, au moment où l’OMS pense tenir une nouvelle réforme de la CIM en parlant d’« incongruence de genre », ce « reste » à côtés de normes binaires de genre et de sexe entre adhésion et contraintes, et que la France des « droits des hommes » clame partout et pour la seconde fois qu’elle est le « premier pays à dépathologiser le « transsexualisme ».
Le « texte coup de poing » de Carole Thibaut[15] n’aura servi à rien. Un coup dans l’eau qu’on applaudit et oublie. Il suffit pour s’en convaincre d’examiner la manière dont Py a organisé ce fantasme de la « révolution transgenre » pour s’apercevoir à quoi sert cette mascarade : ne pas tenir compte de l’équilibre difficile entre hommes et femmes, entre majorité et minorités LGBTIQ, et faire de la thématique « genre » une remise en cause du patriarcat que des hommes mettent en scène, seuls aptes à comprendre ce qui se trame et surtout seuls aptes à en « défaire le genre ». Entretemps, trois événements se sont succédé. La Sofect s’affiche au grand jour pour son congrès annuel qu’il titre « Evolutions sociétales », parrainée par la ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn. Partie prenante de la conférence aux Gay Games l’association Acceptess-T. n’a pas pour autant été invitée à la conférence[16]. Une semaine seulement après la fermeture du festival, le Centre de la Langouste à bretelles à Avignon, qui avait été éconduit dans son rôle de lien social, se faisait vandaliser, signe que les violences font et sont la loi du plus grand nombre.
[1] 25 juillet 2017, http://www.europe1.fr/culture/le-prochain-festival-davignon-sera-transgenre-3397478
[2] http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2018/trans-mes-enlla.
[3][3] Sophie Jouve, « Avignon : le chemin intime des transgenres recueilli par Didier Ruiz », 12.07.2018, en ligne : https://culturebox.francetvinfo.fr/theatre/theatre-contemporain/avignon/le-festival-d-avignon/avignon-le-chemin-intime-des-transgenres-recueilli-par-didier-ruiz-276363.
[4] Stéphane Capron, « Didier Ruiz au Festival d’Avignon 2018 avec son spectacle TRANS (més enllà) », 28.02.2018 ; en ligne : https://sceneweb.fr/didier-ruiz-au-festival-davignon-2018-avec-son-spectacle-sur-la-transsexualite.
[5] « Très clairement. Ici on est au Moyen-Age. Voyez-vous des « trans » dans la rue, au bureau ? A Barcelone, c’est très courant. La personne qui travaille à la réception du Théâtre du Lliure est un « trans ». C’est très facile de changer de genre, d’un point de vue administratif. En France, il vous faut passer devant un psychiatre, avoir un rendez-vous à l’hôpital pour suivre un traitement hormonal, cela prend des années et c’est très compliqué ! C’est la révolution de demain. ».
[6] Brigtite Salino, « Avignon : femme ou homme, juste être soi », 12.07.2018, en ligne : https://www.lemonde.fr/festival-d-avignon/article/2018/07/12/femme-ou-homme-juste-etre-soi_5330176_4406278.html.
[7] Philippe Chevilley, « Avignon 2018 : « Trans », le libre choix des genres », 12.07.2018, https://www.lesechos.fr/week-end/culture/spectacles/0301968381401-avignon-2018-trans-le-libre-choix-des-genres-2191813.php.
[8] Jean-François Cadet, « Didier Ruiz, paroles d’innocents », 09.07.2018 ; en ligne : http://www.rfi.fr/emission/20180709-didier-ruiz-trans-avignon.
[9] Fabienne Darge, « Avignon : les questions de genre déclinées en treize épisodes », 13.07.2018, Le Monde ; en ligne : https://www.lemonde.fr/festival-d-avignon/article/2018/07/13/avignon-les-questions-de-genre-declinees-en-treize-episodes_5330792_4406278.html.
[10] Françoise Héritier, Masculin, Féminin. La pensée de la différence. Paris, O. Jacob, 1996.
[11] Violeta ASSIER-LUKIC, 29.01.2018, « « Transgenre » : Olivier Py, explique le choix de sa thématique », https://www.ledauphine.com/vaucluse/2018/01/29/transgenre-olivier-py-explique-le-choix-de-sa-thematique.
[12] Vincent Bouquet, « Phia Ménard éparpille le patriarcat façon puzzle », 22.09.2018 ; en ligne : https://sceneweb.fr/saison-seche-de-phia-menard.
[13] Camille Renard, « Le geste masculin par excellence, par Phia Ménard », 20.07.2018 ; en ligne : https://www.franceculture.fr/danse/le-geste-masculin-par-excellence-par-phia-menard.
[14] « Saison sèche », en ligne : http://www.lafilature.org/spectacle/phia-menard-saison-seche.
[15] « “Les femmes se font baiser” : le texte coup de poing de Carole Thibaut au Festival d’Avignon », 22.07.2018 ; en ligne : https://sceneweb.fr/les-femmes-se-font-baiser-le-texte-coup-de-poing-de-carole-thibaut-au-festival-davignon/
[16] Acceptess-T participe aux Gay Games Paris 2018, en étant privée de parole 03.08.2018 ; en ligne : https://www.facebook.com/notes/acceptess-transgenres/acceptess-t-participe-aux-gay-games-paris-2018-en-etant-priv%C3%A9e-de-parole/1974710756152654/
Mise en ligne : 13.08.2018